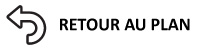LE VERGER
Cette plantation d’arbres fruitiers peut paraître surprenante.
Là aussi, il est rappelé la vie du château. En effet, à l’époque, il existait la ferme du château qui alimentait en fruits, légumes, volailles et viandes tout le personnel qui vivait au sein du château.
De nombreux arbres fruitiers longeaient la rivière Deule dite La Souchez, aujourd’hui enterrée.
Une rue que l’on appelait la « rue du saulchoy », traversait le « bois du plantis » planté essentiellement de saules car le sol était assez humide à cet endroit-là.
Le plantis était un endroit réservé à la coupe des arbres pour se chauffer ; c’était un droit seigneurial là également.
Des cerisiers, des pommiers, poiriers, noisetiers y sont plantés. Ils feront le bonheur des abeilles au printemps.
4 ruches implantées dans le jardin public fournissent près de 80 kg de miel chaque année et rappellent les ruches existantes dans le parc du château.
2 autres ruches sont implantées dans le secteur nord de Liévin.
Les abeilles butineuses ont en charge l’approvisionnement de la ruche. Une fois posée sur une plante à fleurs (angiospermes), l’abeille en écarte les pétales, plonge la tête à l’intérieur, allonge la langue et aspire le nectar qu’elle stocke provisoirement dans son jabot. Du fait de leur anatomie et en particulier de la longueur de leur langue, les abeilles ne peuvent récolter le nectar que sur certaines fleurs, qui sont dites alors mellifères.
Les abeilles peuvent aussi récolter du miellat, excrétion produite par des insectes suceurs comme le puceron, la cochenille ou le metcalfa à partir de la sève des arbres. Il sera utilisé de la même façon que le nectar de la fleur (c’est ce produit de base qui est notamment utilisé pour élaborer le miel de sapin).
L’élaboration du miel commence dans le jabot de l’ouvrière, pendant son vol de retour vers la ruche. L’invertase, une enzyme de la famille des diastases, est ajoutée, dans le jabot, au nectar. Il se produit alors une réaction chimique, l’hydrolyse du saccharose qui donne du glucose et du fructose.
Arrivée dans la ruche, l’abeille butineuse régurgite le nectar à une receveuse (trophallaxie) qui, à son tour, régurgitera et ré-ingurgitera ce nectar riche en eaux, en le mêlant à de la salve et à des sucs digestifs, ayant pour effet de compléter le processus de digestion des sucres. Une fois stocké dans les alvéoles, le miel est déshydraté par une ventilation longue et énergique de la part précisément des ouvrières ventileuses. Parvenu à maturité, le miel a une durée de conservation extrêmement longue.
La chaleur de la ruche ainsi que les ouvrières ventileuses, qui peuvent entretenir un courant d’air pendant 20 minutes dans la ruche, provoquent l’évaporation de l’eau. Le miel arrive à maturité lorsque sa teneur en eau devient inférieure à 18 % ; il est alors emmagasiné dans d’autres alvéoles qui seront operculés une fois remplis.
Le miel est ainsi stocké par les abeilles pour servir de nourriture ; en particulier pendant les saisons défavorables, en saison sèche pour les Apis dorsata ou l’hiver pour Apis mellifera.
Le scientifique Bernd Henrich a mesuré le volume de travail effectué par les abeilles butineuses. Ainsi, pour produire un livre de miel, les abeilles doivent effectuer plus de 17 000 voyages, visiter 8 700 000 fleurs, le tout représentant plus de 7 000 heures de travail.
Un peu d’histoire :
Présent dans le delta du Nil et à Sumer, le miel servait à sucrer les aliments. Plusieurs papyrus égyptiens en font mention, le plus vieux étant celui dit d’Edwin Smith, datant de plus de 4 500 ans. En plus de sa consommation comme aliment ou condiment, il a été utilisé dès l’Antiquité pour embellir la peau et soigner les blessures. Le latin mel a donné le français miel.
Lors des jeux olympiques antiques, les athlètes buvaient de l’eau miellée pour retrouver rapidement leurs forces. Hippocrate (le plus grand médecin de l’Antiquité, 460/377 av. J.-C.) disait que l’usage du miel conduisait à la plus extrême vieillesse, et le prescrivait pour combattre la fièvre, las blessures, les ulcères et les plaies purulentes. Dans l’Antiquité, le miel de la Narbonnaise était considéré comme l’un des meilleurs.
Dans la Rome antique, les premiers apiculteurs distinguent deux sortes de miel : le miel le plus cher et le meilleur, récolté sous les ruches car il s’agissait du miel qui en tombait, et un miel de moindre qualité obtenu après broyage des ruches d’abeilles, moins cher.
A partir du Moyen Age en Chine, puis en Europe, il sert à la fabrication du pain d’épices.
Jusqu’à l’époque de Paracelse, le miel jouissait d’une haute estime en médecine. Il était utilisé notamment comme agent antiseptique pour la guérison des infections et s’avère efficace pour le soin en douceur de verrues, boutons infectieux, furoncles…
Durant les première et seconde guerres mondiales, on l’utilisait pour accélérer la cicatrisation des plaies des soldats.
En dermatologie, pour activer la cicatrisation des plaies et brûlures, mais aussi en cas d’herpès, d’hémorroïdes et de fissures anales, d’eczéma et de psoriasis, de mycoses ou encore d’escarres, si difficiles à soigner ;
Pour le système digestif, constipation, gastroentérite, mycoses digestives et acidité gastrique, le miel inhibe ainsi la fameuse bactérie Helicobacter pylori, mise en cause dans l’ulcère de l’estomac.
Contre les rhumatismes, le venin d’abeille, pour sa part, était déjà mentionné par le père de la médecine, Hippocrate, comme remède idéal contre les affections rhumatismales.
Le venin n’est pas un remède scientifiquement validé, mais il continue à être utilisé en cas de maladies rhumatismales et de sclérose en plaques avec des effets parfois spectaculaires.